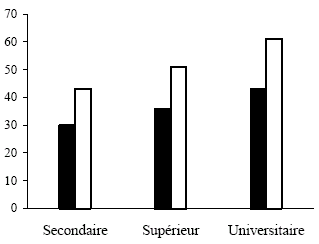Dans le cadre de la préparation de la session des Nations Unies relative à l’évaluation du programme d’action Pékin+10, une réunion ministérielle s’est tenue récemment. Il en est résulté une déclaration faite à Luxembourg, dont nous vous livrons le texte.
Nous, ministres des 25 États membres chargés de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes, participant à la conférence des ministres de l’Union européenne du 4 février 2005 à Luxembourg, dans le cadre de l’examen de la mise en oeuvre du programme d’action Pékin + 10 et des textes issus de la 23è session de l’Assemblée générale qui s’est tenue en 2000;
- prenons acte des conclusions du rapport de la présidence luxembourgeoise sur les progrès réalisés par l’Union élargie relative à la mise en oeuvre de la plate-forme d’action de Pékin ainsi que des conclusions de la conférence de la présidence sur l’examen de la mise en oeuvre du programme d’action de Pékin, qui s’est également tenue à Luxembourg les 2 et 3 février 2005;
- réaffirmons avec vigueur notre soutien et notre engagement en faveur de l’application intégrale et effective de la déclaration de Pékin et de la plate-forme d’action de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, de la déclaration politique de Pékin + 5 et des textes issus de la 23è session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies ainsi que des conclusions adoptées lors des sessions de la Commission sur le statut de la femme depuis Pékin;
- rappelons notre engagement visant à parvenir à une mise en oeuvre totale et effective de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes (CEDAW) et de son protocole facultatif;
- réaffirmons avec vigueur notre soutien et notre engagement en faveur de la pleine mise en oeuvre du programme d’action du Caire adopté lors de la Conférence internationale sur la population et le développement (1994), et des mesures essentielles au développement du programme d’action CIPD convenu lors de la CIPD + 5 ainsi que de la Déclaration et du programme d’action de Copenhague ;
- soulignons que l’égalité entre les femmes et les hommes ne peut être envisagée sans garantir les droits sexuels et reproductifs de la femme et réaffirmons qu’un accès accru aux informations relatives à la santé sexuelle et reproductive et aux services de santé est essentiel pour mettre en oeuvre la plate-forme d’action de Pékin, le programme d’action du Caire et les objectifs du Millénaire pour le développement;
- soulignons que l’égalité entre les femmes et les hommes constitue un objectif important en soi et qu’elle est essentielle pour concrétiser tous les objectifs du Millénaire pour le développement, et que la perspective de genre doit être pleinement intégrée lors du réexamen de la déclaration du Millénaire à un haut niveau, y compris les objectifs du Millénaire pour le développement;
- reconnaissons que la pleine jouissance de tous les droits fondamentaux par les femmes et les filles fait inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne et est essentielle au progrès de la condition des femmes et des filles, à la paix et au développement;
- encourageons l’implication active des hommes et des garçons dans la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes;
- garantissons que toutes les mesures sont cohérentes par rapport aux principes de non-discrimination reconnus au niveau international, y compris la discrimination multiple fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou la croyance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, et qu’elles tiennent compte du respect des droits de la personne et des libertés fondamentales des victimes de telles discriminations; reconnaissons également que des progrès visant à atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes ont été réalisés au cours des dix dernières années mais que des inégalités persistent et que de multiples barrières empêchent la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes, la promotion et l’émancipation des femmes dans la plupart des domaines stratégiques de la plate-forme d’action de Pékin ;
- soulignons qu’il est essentiel que les États membres de l’UE agissent en partenaires afin de profiter de la 49è session de la Commission de la condition de la femme pour réaffirmer pleinement, sans équivoque et unanimement leur engagement en faveur de la Déclaration et de la plate-forme d’action de Pékin ainsi que des textes issus de la 23è session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies, pour procéder à un examen et une évaluation des progrès réalisés depuis Pékin et Pékin + 5, pour identifier les obstacles et les défis actuels et pour convenir des prochaines actions et initiatives à adopter en vue de poursuivre la mise en oeuvre et la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.
1. Mécanismes institutionnels
Soulignons que les structures et les mécanismes institutionnels au niveau européen et national sont les principaux vecteurs par l’intermédiaire desquels la plate-forme d’action peut être menée à bien et qu’ils doivent agir comme catalyseurs en faveur de l’intégration de la dimension de genre et de l’égalité entre les femmes et les hommes. acceptons
- d’assurer que les organismes et les structures chargés de l’égalité des sexes disposent des ressources financières et humaines et des capacités suffisantes pour fonctionner correctement; de garantir un engagement politique fort au plus haut niveau, ainsi que des mandats et des fonctions claires afin d’assurer l’émancipation et la promotion de la femme et d’appliquer la législation, de développer des actions spécifiques et de mettre en application l’intégration de la dimension de genre;
- de renforcer le dialogue et la coopération avec la société civile et les partenaires sociaux;
- de garantir l’égalité entre les femmes et les hommes au titre de et devant la loi, et de créer un environnement susceptible de permettre la transposition des droits;
- de prendre des mesures concrètes pour mettre en oeuvre l’intégration de la dimension de genre et des actions spécifiques pour établir l’égalité entre les femmes et les hommes, y compris la création et la mise en oeuvre de plans d’action nationaux pluriannuels en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et de poursuivre l’élaboration de l’expertise et de la formation sur l’égalité entre les sexes;
- d’identifier les processus et les instruments qui permettent une meilleure responsabilité pour aborder les questions d’égalité entre les femmes et les hommes;
- de développer des méthodes et des instruments d’intégration de la dimension de genre, notamment l’établissement des budgets publics selon la perspective de genre, l’audit selon le genre et les évaluations de l’impact selon le genre, en tant que priorités pour l’avenir;
- de continuer à améliorer le recueil, la compilation et la propagation de données ventilées par sexe fiables, précises et comparables;
- de définir des objectifs dans le temps et de les mettre progressivement à jour, notamment en impliquant des organisations statistiques nationales et internationales;
- de contrôler les progrès en rapportant et en évaluant régulièrement les résultats afin d’établir une évaluation et un contrôle plus cohérents et systématiques de la mise en oeuvre de la plate-forme d’action.
2. Égalité entre les femmes et les hommes, emploi, économie et pauvreté
Reconnaissons que l’égalité entre les femmes et les hommes est essentielle à la réalisation du plein emploi, de la croissance économique, du renforcement de la protection sociale et de l’éradication de la pauvreté; renforçons le lien entre la mise en oeuvre de la plate-forme d’action de Pékin les objectifs du Millénaire pour le développement et la stratégie de Lisbonne adoptée par le Conseil européen en 2000 afin de consolider la réforme économique et la cohésion sociale dans le cadre d’une économie européenne plus forte fondée sur la connaissance; reconnaissons que le taux d’emploi et le chômage chez les femmes ainsi que l’écart de rémunérations entre les hommes et les femmes, la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail, le partage inégal entre les femmes et les hommes du fardeau que représente le travail non rémunéré, et les déséquilibres hommes – femmes en matière de prise de décision demeurent des défis pour l’Union européenne. acceptons
- d’intensifier les efforts afin de lutter contre l’exclusion sociale et de surmonter les obstacles à la participation des femmes au marché de l’emploi, y compris par le biais de mesures destinées à lutter contre la discrimination et l’exploitation sur le lieu de travail;
- de développer, parallèlement aux mesures destinées à accroître la compétitivité et la productivité, des stratégies destinées à augmenter le nombre de femmes actives et d’emplois de qualité pour ces dernières, à garantir et à protéger les droits des femmes actives et à supprimer les barrières structurelles, juridiques et psychologiques relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes au travail;
- de promouvoir les politiques permettant aux femmes et aux hommes d’équilibrer leur vie professionnelle et privée ainsi que leurs responsabilités familiales; de réformer, si nécessaire, les systèmes fiscaux et d’allocations sociales pour créer des incitations économiques permettant aux femmes d’accéder à un emploi, de conserver un poste ou -de reprendre le travail et d’encourager les hommes à prendre part aux responsabilités et tâches familiales;
- de mettre un terme à l’inégalité salariale entre les hommes et les femmes par une approche diversifiée abordant des facteurs sous-jacents, y compris la ségrégation sectorielle et professionnelle, l’éducation et la formation, les classifications professionnelles et les systèmes de rémunération; de promouvoir et de soutenir le travail indépendant pour les femmes, le développement de petites entreprises par celles-ci, et leur accès au crédit, y compris au micro-crédit et aux capitaux, ce d’égal à égal avec les hommes;
- d’intégrer l’analyse selon le genre dans la conception, la mise en oeuvre et l’évaluation des mesures, notamment celles concernant les politiques macroéconomiques et la diminution de la pauvreté; d’utiliser des mesures, des objectifs et des critères d’évaluation quantifiables pour assurer un contrôle et une évaluation adéquats des progrès réalisés;
- de supprimer les obstacles rencontrés par les femmes, y compris les femmes migrantes et autres femmes marginalisées, et de promouvoir leurs chances en matière d’accès et de participation aux prises de décisions économiques à tous les niveaux. (suite accessible sur Internet)